lundi 31 mars 2008
Trouver la source [extraits] Charles Juliet
[…]
De la sorte, ces mouvements très ténus, en prenant corps, deviennent de timides poussées de vie, désirs confus, balbutiantes intuitions, menues découvertes, rappels de sensations, de souvenirs… , ces murmures à peine audibles par lesquels le plus obscur se dégage de l’indifférencié et cherche à se faire entendre.
Charles Juliet, Trouver la source, Paroles d’Aube, 1994, p.75-76.
De la joie et de la tristesse Khalil Gibran
De la joie et de la tristesse
Une page consacrée a Khalil Gibran existe, La version intégrale du Prophète( en anglais) y est consultable.
Une femme dit alors:
"Parle-nous de la Joie et de la Tristesse."
Il répondit:
Votre joie est votre tristesse sans masque.
Et le même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes.
Comment en serait-il autrement ?
Plus profonde est l'entaille découpée en vous par votre tristesse, plus grande est la joie que vous pouvez abriter.
La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle que le potier flambait dans son four ?
Le luth qui console votre esprit n'est-il pas du même bois que celui creuse par les couteaux ?
Lorsque vous êtes joyeux, sondez votre coeur, et vous découvrirez que ce qui vous donne de la joie n'est autre que ce qui causait votre tristesse.
Lorsque vous êtes triste, examinez de nouveau votre coeur. Vous verrez qu'en vérité vous pleurez sur ce qui fit vos délices.
Certains parmi vous disent: "La joie est plus grande que la tristesse", et d'autres disent: "Non, c'est la tristesse qui est la plus grande."
Moi je vous dit qu'elles sont inséparables.
Elles viennent ensemble, et si l'une est assise avec vous, a votre table, rappelez-vous que l'autre est endormie sur votre lit.
En vérité, vous êtes suspendus, telle une balance, entre votre tristesse et votre joie.
Il vous faut être vides pour rester immobiles et en équilibre.
Lorsque le gardien du trésor vous soulève pour peser son or et son argent dans les plateaux, votre joie et votre tristesse s'élèvent ou retombent.
Khalil Gibran
dimanche 30 mars 2008
samedi 29 mars 2008
J"étais là... Nicolas de Rosanbo
J’étais là, dans cette ville qui m’observait de tous ses yeux, fenêtres, tours, lumières. Elle m’enfonçait à ses pieds goudronneux et je sentais ses cimes se refermer sur mon centre. Elle riait effroyablement fort aux méandres de ses avenues, longs vaisseaux sanguins sur une peau de fer. J’entendais grimper jusqu’à mon lit rouillé ses éclats retentissants. Mon lit, ma chambre, immonde bulle parmi tant d’autres, dans son ventre trop rempli qui menace d’accoucher. Petite boite au fond du tiroir d’un immeuble, cage animale encerclée par d’autre cage, alvéole dans un foi, casserole sous un couvercle de cuivre scellé par Dieu lui-même, reposant sur les flammes du centre de la terre. J’étais là, j’arpentais son estomac infecté de gaz et de fumées. Je vivais dans ses entrailles décomposées. J’appartenais à son peuple, comme les rats appartiennent à un égout saturé. J’appartenais à ses lois, à sa vie. J’étais là
Nicolas de Rosanbo
jeudi 27 mars 2008
Bulle [extrait ] Le buveur de temps Philippe Delerm

Aquarelle de Jean-Michel Folon©
Oui, c’est moi dans la bulle, à la surface du papier glacé. Votre main passe sur le livre, caresse le mirage, et ne dérange rien. Je suis dans la couleur du jour ; une aube imperceptible, ou bien peut-être un soir ; dans cette nuance idéale des premières pages : le rose informulé, tremblant, de tout ce qui commence, et d’avance le bleu voilé d’une mélancolie légère –il est toujours très tard dans le premier matin du monde. Mais vous avez tourné la page, écarté doucement le rideau froid de l’apparence, et je vais naître au monde ; il suffit d’un regard.
Je suis bien dans ma bulle. Bien ? Le mot résonne étrangement sur les parois de ma planète ; il est monté de votre terre en ondes chaudes, c’est vous qui l’avez suggéré. Enfin vous êtes au bord de me parler. Moi depuis si longtemps je vous regarde, à travers le grand voile. J’attendais. Je préparais en moi la douceur infinie de votre geste. Vous écartez le voile, et je suis presque là. Je vous connais. Vos rêves en mouvement, vos peurs, vos espérances, à l’ombre effrayante et magique de cet élan qui vous possède, et que vous appelez le temps. Je devine un peu son pouvoir, mais je ne recevrai jamais de lui la vie, la mort, le fil inexorable d’un destin. Effleurer seulement son bonheur, sa blessure ; voilà sans doute mon désir secret.
La bulle flotte dans l’espace et grandit lentement vers vous. Lenteur, silence, transparence : le monde d’où je viens vous fait envie, je crois. Je lis dans vos regards ce rêve d’un sommeil flottant dans la lumière. Mais vous le gardez pour plus tard, et passant devant le tableau vous dites simplement « c’est beau », en prolongeant ces mots pour plonger dans mon ciel une seconde. « C’est beau, très beau », et puis vous allez repartir. La beauté ne vous suffit pas. Vous avez tellement mieux qu’elle. Ce vent qui vous possède et que je comprends mal, ce besoin de bouger, d’aller vers autre chose. Pourtant, vous êtes entré dans le musée pour arrêter le temps. Tous les tableaux, comme le mien, dans cette pièce fraîche à l’ombre de l’été vous réclamaient l’oubli. Vous vous êtes arrêté. Vous avez pressenti l’éloignement de mon appel, au-delà du désert de sable. Et vous écartez le rideau. Votre soif secrète et la douceur de votre main ont tourné la première page, et commencé l’histoire d’un personnage différent. Je suis bien dans un cadre, c’est bien le début d’un romaN. Mais je vous donnerai la courbe de ma bulle, le centre lent de mon regard, les gestes gourds de mon corps effacé pour mieux se couler dans l’espace, ne rien comprendre et ne rien pénétrer, pour mieux se fondre et regarder.
Ne vous méprenez pas. Malgré mon espace ovoïde, mon corps informulé, je n’ai rien d’un fœtus. Je ne viens pas d’un autre monde par la chair et le sang ; aucune hérédité ne m’impose un projet, des limites. Non, si je viens au monde, c’est un peu comme dans le poème de Supervielle, vous savez :
« Il vous naît un oiseau dans la force de l’âge
En plein vol et cachant votre histoire en son cœur
Puisqu’il n’a que son cri d’oiseau pour la montrer. »
Voilà, c’est ça. Je suis un ami inconnu. Je viens sur terre pour nouer entre nous ce lien fragile qui n’a pas de nom. Pas encore. Amour, amitié, tendresse, les mots sont codifiés, pour un usage et des rapports précis. Mais entre nous, ce sera bien plus vague.
J’étais bien dans ma bulle. Je le sens maintenant à la fraîcheur de l’air d’ici, qui brûle un peu ; l’air de ma planète était parfait, il n déchirait pas la poitrine, ne donnait pas envie de bouger, de changer. C’était un long sommeil, les yeux ouverts dans les eaux du soleil. C’était la solitude aussi, mais je vous regardais. Êtes-vous bien sur terre ? Excusez-moi. Êtes-vous bien, sur terre ?
Votre réponse est un silence, l’ébauche d’un sourire au coin des lèvres. J’aime bien ce silence, où je sens quelques gouttes de temps pur à la tristesse douce-amer. J’aime bien ce sourire, l’humour est la pudeur des jours –vous êtes tellement civilisé.
Bulle [extrait ] Le buveur de temps Philippe Delerm
source : http://pagesperso-orange.fr/mondalire/fatext%20r%E9cap.htm
mercredi 26 mars 2008
Egon Schiele, extrait, recueil "moi, l'éternel enfant"

Egon Schiele
J’AIMAIS TOUT
Je voulais regarder les Hommes en colère avec amour
Pour obliger leurs yeux à me rendre la pareille
Et les envieux, je voulais les combler de cadeaux et dire
Que je ne valais rien. …
J’entendais de doux vents - tourbillons
Fendre les lignes d’air
Et la jeune fille,
Qui lisait d’une voix plaintive,
Et les enfants
Qui me regardaient avec de grands yeux
Et répondaient par des caresses au regard que je leur rendais
Et les nuages au loin
Ils posaient leurs bons yeux plissés sur moi.
Les jeunes filles blafardes et blanches me montraient
Leurs jambes noires et leurs jarretelles rouges
Et parlaient avec des doigts noirs.
Mais moi, je pensais aux mondes lointains:
digitales.
Si j’étais là moi-même,
Je l’avais à peine su.
Egon Schiele, extrait, recueil "moi, l'éternel enfant"lundi 24 mars 2008
Teishin & Ryôkan
Est-ce vraiment toi que j'ai vu
ou cette joie que je ressens encore
est-elle seulement un rêve?
-- Teishin
Dans ce monde d'illusion
nous sommeillons et parlons de rêve.
Rêve, continue à rêver, autant qu'il te plaira.
-- Ryôkan
Ici avec toi je pourrais demeurer
des jours et des années
silencieuse comme la pleine lune
que nous avons regardée ensembles.
-- Teishin
M'as-tu oublié
ou as-tu oublié le chemin de ma demeure?
Je t'ai attendue tout le jour, tous les jours
mais tu n'es pas venue.
-- Ryôkan
La lune, j'en suis sûre, brille haut dans le ciel
au-dessus des montagnes
mais de sombres nuages amoncelés
en noient le sommet dans l'ombre
--Teishin
Tu dois t'élever
au-dessus des nuages sombres
couvrant le sommet de la montagne
sinon comment pourrais-tu jamais voir la lumière?
-- Ryôkan
dimanche 23 mars 2008
Marina Tsvetaeva "... Je ressusciterai le réverbère."
Je ne dirais pas que vous m’êtes indispensable, vous êtes in-contournable dans ma vie, où que je pense, le réverbère se dressera sur tous mes chemins. Je ressusciterai le réverbère.
Marina Tsvetaeva
vendredi 21 mars 2008
jeudi 20 mars 2008
"Forêt des ombres" Georges Haldas
pas à pas je m'avance
Un escalier secret
y mène vers les eaux
du sommeil où je vois
dans un léger brouillard
une façade rose
Volets clos et silence
J'ai dû rêver un jour
d'une telle demeure
où mon double se rend
au-delà de la mort
et cependant vivant
Et moi je le regarde
dans mon lit solitaire
s'éloigner pas à pas
Descendre l'escalier
vers les eaux du sommeil
où se perdent les voix
Georges Haldas
"Forêt des ombres" in Un Grain de blé dans l'eau profonde,
éd. Orphée / La Différence, p. 144.
"Cette étrange émotion... Georges Haldas



"Cette étrange émotion que j'éprouve chaque fois en voyant, suspendu au portemanteau, une veste ou un chapeau. Qui me semble toujours comme le double abandonné de celui qui le porte. Ou, si on veut encore, comme le fantôme de sa présence."
Georges Haldas
Vertige - Georges Haldas
Vertige
Ni le temps ni le fruit
Ni l'ombre ou ce qui luit
Ni les jardins tranquilles
Ni la fureur des bêtes
Ni fièvres ni prières
ne m'assurent. Je suis
le vertige en personne
Un écho de celui
que l'on croit que je suis
mercredi 19 mars 2008
La poésie est une arme chargée de futur - Gabriel Celaya
|
La poesia est un arma cargada de futuro.
Ma poésie n'est pas goute à goutte pensée. Ce n'est pas une fleur. Ce n'est pas un fruit parfait. C'est ce qui est nécessaire, ce qui n'a pas de nom, des actes sur la terre, un cri vers l'horizon.
No es una poesia gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fructo perfecto, es lo às necesario : lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.
Poème (extrait) de Gabriel Celaya (poète espagnol / 1911-1991). Traduction de Pierre Pascal. Chanté par Paco Ibanez. |
mardi 18 mars 2008
Ecrire la voix par Charles Juliet
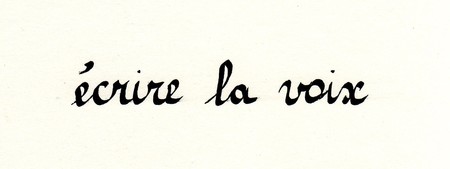
Ma voix, il lui a fallu un long temps pour mourir.
J’avais en tête le mot mûrir, et je m’aperçois que je viens d’écrire mourir.
J’accueille donc ce mot qui s’est subrepticement glissé sous ma plume, et j’écris en toute connaissance de cause : ma voix, il lui a fallu un long temps pour mourir.
Cette voix silencieuse qui se confond avec les mots que depuis quelque trente ans, jour après jour, je trace à grand-peine avec un stylo sur des feuilles de papier, un long temps lui a été nécessaire pour mourir aux mots, notions, préoccupations diverses..., qui participaient à son obscur travail et l’alimentaient, mais ne lui appartenaient pas.
Au début, écrire n’était même pas possible. Un trop-plein obstruait la source. La profusion tumultueuse de ce qu’il y avait à dire entraînait un tel bouillonnement, qu’il y avait suffocation, et par voie de conséquence, mutisme.
Puis dans la souffrance, dans une tension de tout l’être, des mots, des bribes de phrases ou de poèmes ont été balbutiés. Par la suite, ces mots se sont faits plus nombreux, et ils ont fini par composer une continuité, par s’articuler, par former une parole cohérente et intelligible.
Durant ces premières années de bredouillante parole, les mots que j’utilisais ne montaient pas de mon propre fonds. Je parle des mots, mais aussi, de ce dont ils sont le support. Aussi, à la faveur des métamorphoses survenues, la voix n’a-t-elle cessé de muer, d’abandonner ses peaux mortes.
Les mots qu’il me fallait employer mais que je n’avais pas eu le temps de porter dans mon sang, de faire miens, étaient vécus comme des corps étrangers, qui altéraient la voix.
Pour que j’aie la sensation de quasiment me confondre avec les mots que j’emploie, il importe qu’ils dorment longuement en moi, se mêlent à ma substance, se nourrissent de mon humus. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils peuvent se charger de ce qu’ils auront à porter au jour.
Ces mots que je ne peux aimer, qui me paraissent morts et n’appartiendront jamais à mon vocabulaire. A l’inverse, ces mots que j’affectionne tout particulièrement, qui ont tendance à revenir plus souvent que d’autres sous ma plume, et que j’appelle des mots-pivots. (En botanique, on appelle pivot la racine principale qui s’enfonce verticalement dans le sol). Ce sont eux qui me servent à pénétrer en des points cruciaux mon sol et mon sous-sol.
Une voix, c’est un mixte de sons-mots-souffle-rythme, à quoi s’ajoute un certain quelque chose propre à chacun. Écrire, ce fut dès l’origine tenter de retrouver le timbre et le rythme de la voix du corps avec les mots que formait la plume.
Pour restituer ce que je perçois de ce qui fermente et bruit dans mes limbes, la voix qui se fait entendre au long de mes mots doit être lente, grave, sourde. Seule une telle voix peut donner à ressentir ce que j’éprouve lorsque, enfoui au plus intime de moi-même, j’ai une conscience aiguë de la beauté et du tragique de la vie.
Écrire, c’est me laisser scander par un rythme. Un rythme qui m’est imposé par celui du souffle. Il est des écritures sans rythme et qui me paraissent physiologiquement fausses.
Écrire la voix, c’est simplement transcrire les mots de cette voix qui ne cesse de murmurer dans le silence de ma nuit.
C’est pour se mettre à l’écoute de cette voix que l’écrivain a besoin de se retirer dans la solitude et le silence.
On a pu prétendre que le regard est le miroir de l’âme. D’une manière semblable, ne pourrait-on dire que la voix pourrait s’entendre comme la musique de l’âme ?
Texte paru dans La Bartavelle N°1 (série dirigée par Pierre Perrin, décembre 1994)
source : http://oceania55.canalblog.com/archives/2008/01/29/7745121.html










