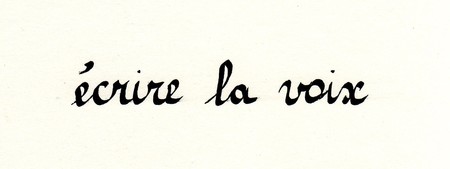
Ma voix, il lui a fallu un long temps pour mourir.
J’avais en tête le mot mûrir, et je m’aperçois que je viens d’écrire mourir.
J’accueille donc ce mot qui s’est subrepticement glissé sous ma plume, et j’écris en toute connaissance de cause : ma voix, il lui a fallu un long temps pour mourir.
Cette voix silencieuse qui se confond avec les mots que depuis quelque trente ans, jour après jour, je trace à grand-peine avec un stylo sur des feuilles de papier, un long temps lui a été nécessaire pour mourir aux mots, notions, préoccupations diverses..., qui participaient à son obscur travail et l’alimentaient, mais ne lui appartenaient pas.
Au début, écrire n’était même pas possible. Un trop-plein obstruait la source. La profusion tumultueuse de ce qu’il y avait à dire entraînait un tel bouillonnement, qu’il y avait suffocation, et par voie de conséquence, mutisme.
Puis dans la souffrance, dans une tension de tout l’être, des mots, des bribes de phrases ou de poèmes ont été balbutiés. Par la suite, ces mots se sont faits plus nombreux, et ils ont fini par composer une continuité, par s’articuler, par former une parole cohérente et intelligible.
Durant ces premières années de bredouillante parole, les mots que j’utilisais ne montaient pas de mon propre fonds. Je parle des mots, mais aussi, de ce dont ils sont le support. Aussi, à la faveur des métamorphoses survenues, la voix n’a-t-elle cessé de muer, d’abandonner ses peaux mortes.
Les mots qu’il me fallait employer mais que je n’avais pas eu le temps de porter dans mon sang, de faire miens, étaient vécus comme des corps étrangers, qui altéraient la voix.
Pour que j’aie la sensation de quasiment me confondre avec les mots que j’emploie, il importe qu’ils dorment longuement en moi, se mêlent à ma substance, se nourrissent de mon humus. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils peuvent se charger de ce qu’ils auront à porter au jour.
Ces mots que je ne peux aimer, qui me paraissent morts et n’appartiendront jamais à mon vocabulaire. A l’inverse, ces mots que j’affectionne tout particulièrement, qui ont tendance à revenir plus souvent que d’autres sous ma plume, et que j’appelle des mots-pivots. (En botanique, on appelle pivot la racine principale qui s’enfonce verticalement dans le sol). Ce sont eux qui me servent à pénétrer en des points cruciaux mon sol et mon sous-sol.
Une voix, c’est un mixte de sons-mots-souffle-rythme, à quoi s’ajoute un certain quelque chose propre à chacun. Écrire, ce fut dès l’origine tenter de retrouver le timbre et le rythme de la voix du corps avec les mots que formait la plume.
Pour restituer ce que je perçois de ce qui fermente et bruit dans mes limbes, la voix qui se fait entendre au long de mes mots doit être lente, grave, sourde. Seule une telle voix peut donner à ressentir ce que j’éprouve lorsque, enfoui au plus intime de moi-même, j’ai une conscience aiguë de la beauté et du tragique de la vie.
Écrire, c’est me laisser scander par un rythme. Un rythme qui m’est imposé par celui du souffle. Il est des écritures sans rythme et qui me paraissent physiologiquement fausses.
Écrire la voix, c’est simplement transcrire les mots de cette voix qui ne cesse de murmurer dans le silence de ma nuit.
C’est pour se mettre à l’écoute de cette voix que l’écrivain a besoin de se retirer dans la solitude et le silence.
On a pu prétendre que le regard est le miroir de l’âme. D’une manière semblable, ne pourrait-on dire que la voix pourrait s’entendre comme la musique de l’âme ?
Texte paru dans La Bartavelle N°1 (série dirigée par Pierre Perrin, décembre 1994)
source : http://oceania55.canalblog.com/archives/2008/01/29/7745121.html





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire